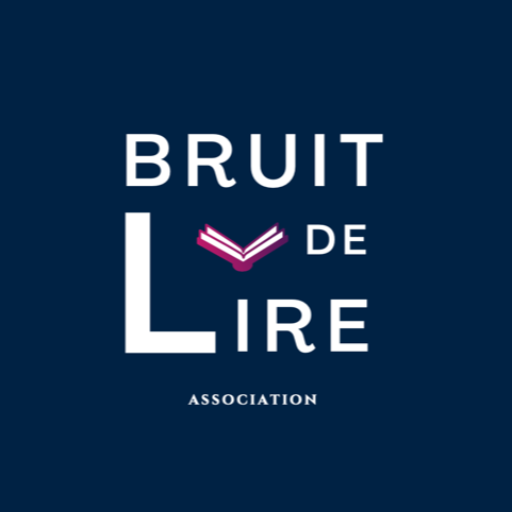Madelaine avant l’aube – Sandrine Collette
(JC Lattès 2024)
Nos existences sont courtes, sauvages, éreintantes.
Dans le propos tenu lors de la proclamation par leur présidente, les lycéens du jury national ont d’emblée pointé ce qui, selon eux, fait la singularité du texte de Sandrine Collette :
« Nous avons été sensibles aux thématiques actuelles dans un roman pourtant intemporel. »
Actualité des thèmes (inégalités sociales, violence, dérèglement climatique…), intemporalité du roman (aucune date n’est mentionnée, même si…). Une dualité qui donne toute sa force à l’ensemble.
Un cadre spatio-temporel à la fois précis et comme stylisé
Si Sandrine Collette ne fournit volontairement aucune date précise permettant de situer son récit dans le temps, quelques indices permettent néanmoins à un lecteur attentif de se faire une idée. Il apparaît, tout d’abord, que la structure sociale est celle de l’Ancien Régime (des paysans soumis à un seigneur qui exerce un pouvoir absolu et s’autorise bien des exactions, la chasse réservée au seul seigneur…) : nous sommes donc avant 1789, sauf à se lancer dans des hypothèses aventureuses autour d’un récit post apocalyptique (domaine que l’autrice a exploré dans des œuvres précédentes et que, lors de ses interventions, elle n’a pas exclu). Par ailleurs, à la page 150, il est question des « terribles années de la fin du siècle » au cours desquelles sont morts les parents d’Eugène : « ces deux années de grande famine », lit-on un peu plus loin. Or on sait qu’elles correspondent, historiquement, aux années 1693 et 1694. Tout cela nous conduit à considérer que nous sommes dans les premières années du XVIIIème siècle. Pour autant, plus que la chronologie romanesque au sens strict que l’on ne saurait établir avec rigueur, ce qui importe c’est la succession des saisons dans une durée assez large. Le temps pour les enfants d’Eugène de grandir et d’accéder à l’âge adulte pour ce qui est de Germain, l’aîné. Le temps aussi, pour certains, de mourir. Les saisons ont un caractère bien marqué, dans un environnement dominé par les forces naturelles : l’hiver, bien sûr, le dernier étant particulièrement rude, mais aussi le printemps, ambivalent puisqu’il est à la fois signe de renaissance, mais aussi le moment de la tragédie finale qui a lieu la veille des saints de glace, donc le 10 mai. Les saints de glace (11, 12 et 13 mai) correspondant justement à l’ultime sursaut de l’hiver, avec des conséquences sur les cultures qui peuvent être désastreuses.
L’espace, lui, est fortement structuré. Un espace clos que, dans la plupart des cas, on ne peut quitter. Il y a le pays Arrière (nom qui sonne étrangement), le village de La Foye et ses 160 habitants et, surplombant ce village, le hameau des Montées avec ses trois fermes où vivent les personnages principaux. Cet espace étant délimité par une rivière, significativement dépourvue de pont : le Basilic (un autre nom étrange, inquiétant même). Des forêts et puis au loin la montagne (« l’horizon là-bas où la montagne commence »). On sait aussi qu’il y a un château (celui des Ambroisie, les maîtres), mais on ne fait que s’en approcher (avec crainte), sans jamais y pénétrer. Plutôt que le réalisme dans la description des lieux, ce qui frappe, c’est une dimension poétique et symbolique. D’autant qu’il n’est pas possible de déterminer la région concernée.
Des personnages puissamment campés
Le titre choisi installe au premier plan Madelaine dont on ne sait d’où elle vient et qui surgit « avant l’aube » (dans les périodes difficiles il n’était pas rare d’abandonner un enfant, une bouche à nourrir…). Soulignons que cette apparition se fait au début du chapitre deux (page 69) – ce qui crée pour le lecteur un effet d’attente et donne à cette apparition un relief particulier. Elle n’a alors pas dix ans (plus tard, page 135, elle « a peut-être douze ou treize ans » et, à la fin du roman quelques années de plus donc, peut-être, seize ou dix-sept ans). Enfant sauvage, d’emblée (Rose qui la recueille croyait avoir affaire à un chat) : « Madelaine est sauvage et tendre ». Être contradictoire aussi : « son caractère buté et rancunier, à d’autres moments sa gaieté sans limites ». Elle a, en tout cas, une personnalité singulière et très forte (« Madelaine un diamant que rien n’entaille ») et elle suscite des réactions ambivalentes. Elle fascine tous ceux qui l’approchent, suscite des attachements passionnés (Bran, Artaud, les deux jumelles…). Mais elle est aussi et surtout celle par qui le malheur arrive : « Il [Eugène] a toujours senti que la petite amènerait le malheur », « elle est un feu où nous réchauffons nos mains, un soleil qui embaume nos prés.
Et elle est dangereuse ». Dangereuse aussi parce que, face à des hommes résignés à leur sort, les femmes sont celles qui incarnent ici la révolte. La singularité du personnage se trouve comme soulignée par le a du prénom en lieu et place du e habituel. Au delà de l’explication donnée par l’autrice elle-même de ce choix, on ne peut s’empêcher d’y voir un signe d’élection : de la même manière l’enfant qui est le héros de Juste après la vague est prénommé Louie (au lieu du Louis attendu).
Autour de Madelaine gravitent donc les autres figures romanesques importantes, attachées à chacune des trois fermes : Rose, une vieille femme un peu magicienne, les deux jumelles, Ambre mariée à Léon, sabotier devenu alcoolique, et Aélis mariée à Eugène (eux-mêmes parents de Germain, Artaud et Mayeul). Eugène étant, au côté de Madelaine, l’autre héros du roman, celui qui incarne la soumission à un destin auquel on ne saurait échapper : « Les maîtres sont les maîtres », « les choses ont toujours été ainsi ». Eugène qui franchit tous les jours la rivière pour pratiquer le débardage en compagnie de son cheval Jéricho et cherche à préserver un équilibre fragile (il s’agit de survivre plus que de vivre), face à la force déstabilisante représentée par Madelaine. Dans le débat entre ordre et justice, on est tenté de considérer que l’un est du côté de l’ordre (« Que la vie soit mal faite, nous le savons tous. »), l’autre du côté de la justice.
Mais ce qui relie tous ces êtres, c’est sans doute le lien étroit, souvent douloureux, qu’ils entretiennent avec la nature, une nature rude et impitoyable : « la forêt est notre jardin, notre pays, nos racines ». Tous portent une part d’animalité, caractéristique de l’univers de Sandrine Collette.
Ajoutons que, bien évidemment, on ne saurait oublier celui qui est le narrateur des deux premiers chapitres (à la première personne), soit une moitié de l’ensemble : en l’occurrence Bran, compagnon fidèle de Rose qui l’a recueilli avant Madelaine et de Madelaine à qui il voue un attachement passionné.
Il faut enfin citer, même s’ils restent constamment et volontairement à l’arrière-plan, ceux qui représentent les maîtres : Ambroisie le père et Ambroisie le fils. Un nom qui sonne comme une antiphrase, puisque, dans la mythologie grecque, l’ambroisie est la nourriture délicieuse des dieux qui leur assure avec le nectar l’immortalité. Le fils étant bien pire que le maître, ce qui n’est pas sans signification sur le sens de l’Histoire. Mais l’un et l’autre incarnent un ordre social fondamentalement violent et injuste.
Une construction qui installe la dimension tragique
La construction même du récit est d’une efficacité redoutable. Grâce à ce vaste prologue (on est le 9 mai…) qui dit d’emblée la catastrophe vers laquelle on se dirige. Un prologue comme dans une tragédie. Et, comme dans une tragédie, on ne saurait échapper au destin (« Ce destin même qui a enchaîné Eugène aux Montées ») : le terme (ou des expressions liées) revient, au demeurant, à plusieurs reprises. Comme dans une tragédie aussi, les ressorts essentiels de la terreur et de la pitié sont sollicités. Quels que soient les efforts et le courage de Madelaine, ses tentatives pour échapper à la misère sont vouées à l’échec, comme le révèle la scène où elle veut remplacer Germain et tirer l’araire (page 202 : « c’est elle qui a cédé »). Un échec qui, paradoxalement, vient souligner la grandeur du personnage. Et il faudrait s’arrêter sur le dénouement et l’interprétation à donner du geste de couper ses cheveux et du reflet dans le Basilic où « elle découvre ce très jeune garçon aux yeux bleus ». Un dénouement ouvert, en tout cas, qui empêche de considérer que tout est définitivement perdu, qu’il n’y a rien à faire face aux forces dominantes.
Au terme de ce prologue déterminant au plan esthétique, le texte fait se succéder deux modes de narration. Un récit à la première personne pour les chapitres un et deux et une narration à la troisième personne pour trois et quatre.
Récit à la première personne d’abord avec, pour narrateur, Bran, identité mystérieuse (mais avec Sandrine Collette on est habitué à de tels mystères). Un Bran qui est un personnage à part entière, pétri d’humanité. Une voix qui sonne tellement juste et dont la nature exacte ne se révélera qu’à la toute fin du chapitre deux : révélation finale qui participe largement de la réussite de l’œuvre.
Le passage à la troisième personne pour la seconde moitié impose forcément une prise de distance et autorise la mise en place d’une pluralité de points de vue. Pour autant il n’y a pas de rupture, comme on pourrait s’y attendre, mais plutôt une forme de continuité, le narrateur de la seconde partie n’étant finalement pas si éloigné de cette « humanité » dans le ton dont on a dit qu’elle caractérisait la voix de Bram. Ce narrateur est, certes, omniscient puisqu’il a la capacité de nous dévoiler l’intériorité des différents personnages, mais il semble partie prenante de l’univers évoqué : il reste au plus près des événements et ne se prive pas d’intervenir. Dans le même esprit, le système des temps reste celui du discours (présent et passé composé) et non celui du récit (passé simple). Un choix qui donne au texte une intensité particulière : le lecteur est tenu en haleine et a le sentiment de participer aux différents épisodes.
Une écriture qui lie étroitement familiarité et poésie
L’écriture donne une impression de simplicité, de naturel. Des phrases courtes, une dominante de la parataxe. Des dialogues qui se fondent dans la narration, sans la présence de marques spécifiques – ce qui crée un sentiment de fluidité. On est souvent proche de la langue parlée (« Mais voilà, l’hiver passe. », « Il fait trop chaud oui. »). Si l’orientation d’ensemble nous conduit vers la tragédie, cette tragédie est énoncée sans aucune solennité, mais, au contraire, à travers des expressions empruntées au quotidien le plus banal : « …une belle chose s’accompagne toujours d’une laide », ou encore « On ne peut pas faire confiance à la vie ».
On reconnaît la sensibilité et les expressions du monde paysan. Avec, aussi, des formulations qui sonnent, parfois, de manière un peu archaïque (l’action, on l’a vu, doit se situer au tout début du XVIIIème siècle) : « il faisait si faim », « cela lui donnerait de la rassurance »… Sans que ces traits soient, néanmoins, appuyés. Il s’agit, simplement de créer une atmosphère, une couleur d’époque.
Pour autant, la poésie irrigue l’ensemble. Avec la présence d’images qui ne brisent en aucun cas le naturel recherché. Parce que ces images, qu’il s’agisse de comparaisons ou de métaphores, sont directement liées à l’univers dans lequel vivent les personnages et renvoient aux éléments naturels : « Ambre est une pierre qui peut s’abîmer ; Madelaine un diamant que rien n’entaille. », « Artaud a le visage blanc comme les aubes de l’hiver. ». On pourrait aussi évoquer le travail sur le rythme, cette respiration du texte qui rend compte avec force des émotions.
Sandrine Collette et son univers propre
On ne peut qu’être frappé par la cohérence, à travers les onze romans déjà publiés, de l’univers que propose la romancière et l’on retrouve dans Madelaine avant l’aube bien des traits caractéristiques de son œuvre et de sa personnalité : attachement à la nature, injustice sociale, violence inhérente à la nature humaine, omniprésence de la dimension animale, menaces sur l’environnement…
On n’oubliera pas, à cet égard que son entrée en littérature s’est faite à travers un texte d’une rare sauvagerie, à la lecture éprouvante mais extraordinairement addictive : Des nœuds d’acier. Et la violence est plus ou moins présente dans chacun des romans qui ont suivi. On est très loin du feel good, de la romance et de ses illusions mensongères. Le monde dans lequel nous évoluons reste un monde dur, âpre et l’angélisme n’y a pas sa place : il suffit de penser au sort réservé ici à Siméon, pourtant victime des exactions des maîtres (« Siméon a été enfermé dans une soue par les paysans de la Foye. [..] On l’a étranglé. »). La veine post apocalyptique est d’ailleurs représentée, au sein de son œuvre, dans Et toujours les forêts ou Juste après la vague. Quant à l’animalité, elle est directement manifestée dans deux titres : Animal et On était des loups. Lire Sandrine Collette, c’est accepter de plonger dans les gouffres de l’âme humaine et ses ambiguïtés (on pense, par exemple, au traitement du thème de l’emprise, de la relation toxique dans Ces orages-là).
Ce qui ne signifie pas que tout est noirceur, absence de toute forme d’espoir. On voit ainsi que le dénouement de Madelaine avant l’aube reste ouvert, en dépit de tout le sang qui coule. Quant aux solidarités entre les êtres, elles sont loin d’être absentes, ne serait-ce qu’à travers les liens étroits qui unissent Madelaine aux trois fils d’Eugène (« les Quatre »). Les figures lumineuses ne manquent pas. À commencer par Rose, celle qui recueille Madelaine ou bien les jumelles Ambre et Aélis (et singulièrement la première des deux) ou encore le si émouvant Bran. Et, bien évidemment Madelaine… Une opposition lumière / ombre qui ne cède pas, pour autant, aux facilités du pathos ou du manichéisme, comme on le suggère parfois.
En guise de conclusion
Madelaine avant l’aube, avec ses accents de fable, a été reconnu par les lycéens : on ne peut que s’en réjouir, tant le texte se révèle d’une complexité et d’une qualité littéraire remarquables. On n’oubliera pas, par ailleurs, que le roman figurait parmi les quatre finalistes de l’académie Goncourt et qu’il a connu un succès auprès du public que l’obtention du Goncourt des lycéens est venue, comme chaque année, largement amplifier. Le prix a aussi attiré l’attention sur les œuvres précédentes, On était des loups ayant été, d’ailleurs, antérieurement couronné (2022) par le Renaudot des lycéens. Preuve que l’univers de la romancière parle fortement aux lycéens d’aujourd’hui.
Commentaire écrit par Joël Lesueur